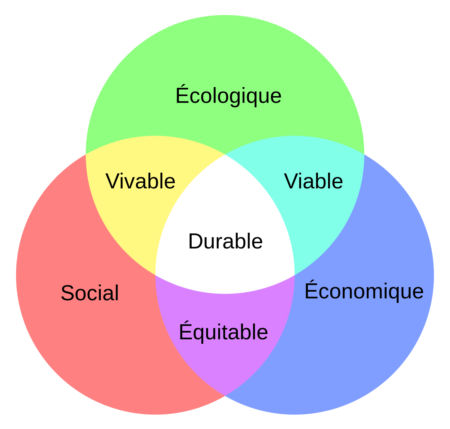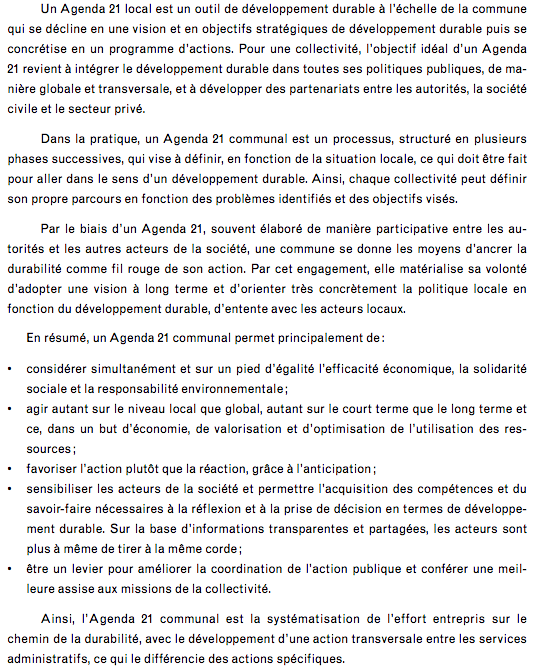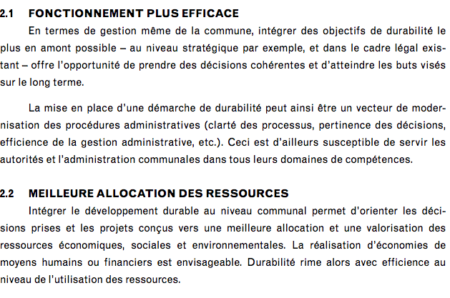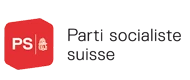Interpellation déposée par Alexandre Rydlo lors de la séance du Grand Conseil de mardi 15.05.2018
Cela fait maintenant la deuxième fois en deux semaines que des hooligans s’adonnent à des actes de violence, troublent gravement l’ordre public, et perturbent la circulation des trains avant ou après des matchs de football de « Super League ».
Dans les villes, ces hooligans brisent la tranquillité publique et s’en prennent non seulement aux hooligans des clubs adverses, ou ennemis dans leur référentiel, mais aussi à la population et aux infrastructures publiques.
Dans les gares, ces hooligans menacent et/ou blessent des voyageurs et le personnel des trains, tout en allant jusqu’à bloquer la circulation des trains et donc le trafic des voyageurs et des marchandises.
Ceci perturbe la vie publique et l’exploitation normale du réseau des CFF, et nécessite toujours l’engagement massif des forces de l’ordre pour rétablir l’ordre et la sécurité, qu’il s’agisse de la Police des transports, des Polices cantonales et/ou des Polices communales.
C’est inadmissible.
A noter que ces deux épisodes ne sont pas les seuls à devoir être mentionnés. C’est régulièrement et presque systématiquement le cas avec les hooligans de certains clubs de football en particulier, notamment les clubs FC Young Boys, FC Grasshopper, FC Sion et FC Basel. Le FC Lausanne-Sport (LS) a bien sûr aussi des problèmes à régler. Il en va de même malheureusement pour certains clubs de hockey, et le Lausanne Hockey Club (LHC) ne fait malheureusement pas exception.
Les cantons ont conclu un Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS, RSV 125.93), et les CFF ont régulièrement dit vouloir revoir leur politique de transport des hooligans en arrêtant de proposer des trains spéciaux pour certains clubs lors des matchs les concernant, notamment ceux dits « à risques ». Les clubs concernés et leurs associations faitières disent aussi régulièrement condamner fermement ces pratiques et s’engager à prendre toutes les dispositions dans le futur pour que de tels incidents ne se reproduisent plus.
On peut toutefois se demander si toutes ces mesures ont bien été mises en oeuvre, ou si elles sont efficaces, puisqu’on continue de voir des épisodes de violence, des troubles, des perturbations dans les gares et des trains bloqués.
Par ailleurs, outre générer des graves problèmes de sécurité publique et d’exploitation du réseau des CFF, ces troubles génèrent des coûts assumés par les collectivités publiques, donc les citoyennes et les citoyens, et qu’il s’agit de répercuter aux générateurs des troubles, principalement les clubs de sport concernés qui ne maitrisent pas leurs fans violents les plus extrémistes. La répercussion de ces coûts est régie par les dispositions de la Loi sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l’Etat lors de manifestations (LFacManif, RSV 172.56), lesquelles doivent être lues en parallèle des dispositions contenues dans la Loi sur la police cantonale (LPol, RSV 133.11) et dans la Loi sur les subventions (Lsubv, RSV 610.15).
Aussi je pose les questions suivantes au Conseil d’Etat.
- Quel bilan le Conseil d’Etat tire-t-il de l’application du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, notamment de sa collaboration avec les associations faitières du football et du hockey en Suisse, et avec les clubs sportifs FC Lausanne-Sport (LS) et Lausanne Hockey Club (LHC) en particulier, pour assurer l’ordre public lors des matchs ? Les dispositions de ce Concordat sont-elles vraiment suffisantes ?
- Quel bilan le Conseil d’Etat tire-t-il de sa collaboration avec les CFF pour assurer l’ordre public dans les gares et aux abords des gares, de même que pour garantir la circulation des voyageurs et des marchandises, lors des matchs ? Le Conseil d’Etat demandera-t-il en particulier aux CFF de supprimer les trains de fans des clubs qui causent des problèmes lors des matchs ?
- Quelles mesures le Conseil d’Etat prendra-t-il avec les autorités sportives et les communes concernées pour empêcher que des violences, troubles et perturbations en lien avec des matchs ne se reproduisent à nouveau dans le futur ?
- Le Conseil d’Etat peut-il fournir des statistiques au sujet du nombre d’interdictions de périmètre, d’obligations de se présenter, de gardes à vue, et de recommandations d’interdiction de stade prononcées dans le Canton de Vaud à l’encontre de personnes violentes en relation avec des manifestations sportives ?
- Le Conseil d’Etat peut-il indiquer quelles sont les conséquences financières des engagements de la police pour lutter contre les violences, troubles et perturbations générées, comment s’applique l’Art. 2 de la Loi sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l’Etat lors de manifestations sur les exonérations (LFacManif, RSV 172.56), pour les événements sportifs du FC Lausanne-Sport (LS) et du Lausanne Hockey Club (LHC), et quel bilan tire le Conseil d’Etat de ces exonérations ? Entend-il en particulier les reconduire et, si oui, à quelles conditions ?
Merci d’avance pour les réponses !
Chavannes-près-Renens, 15.05.2018
Alexandre RYDLO, Député socialiste